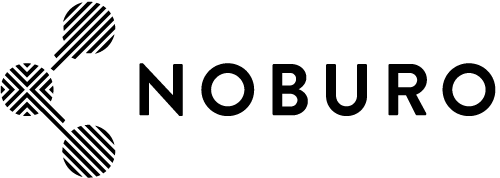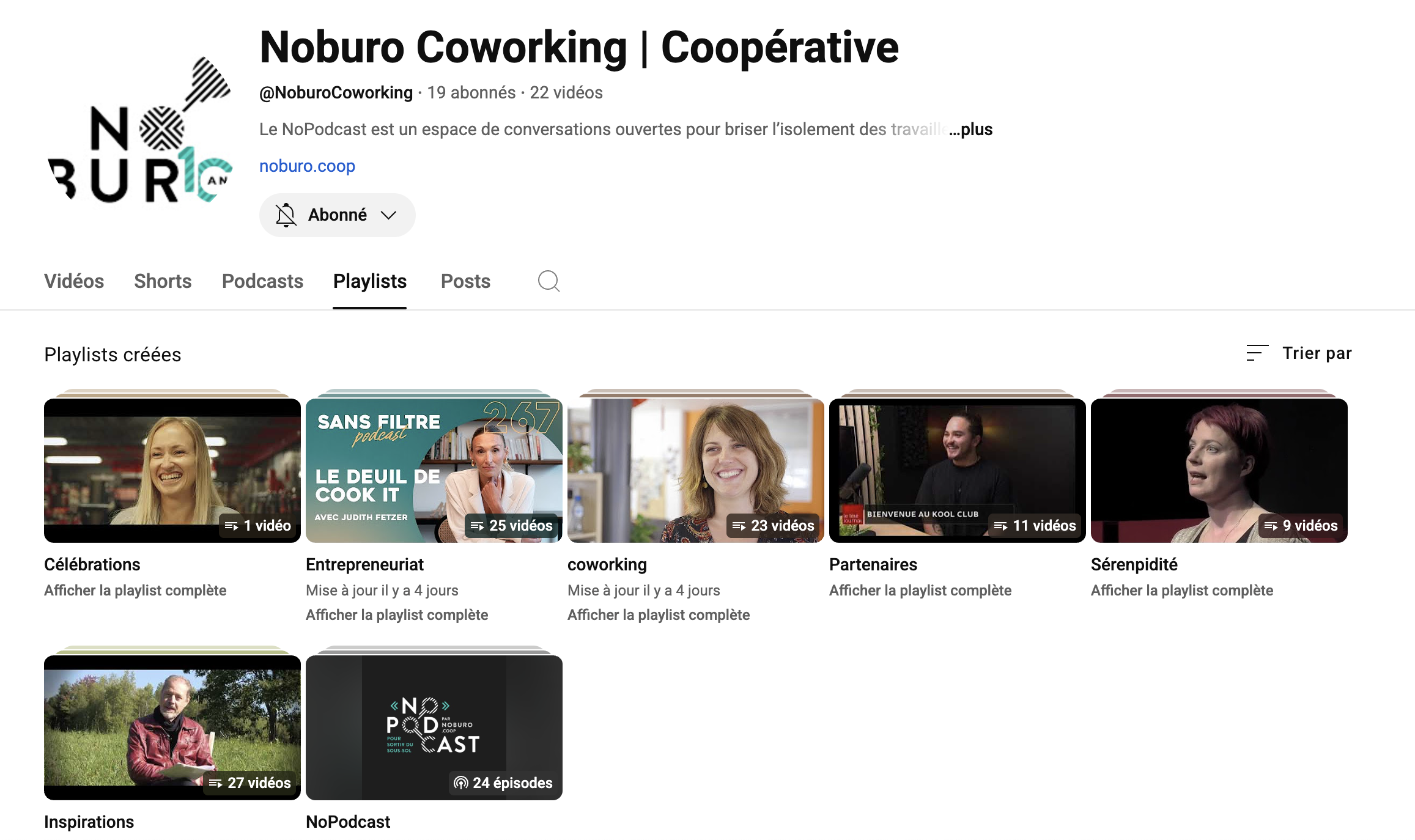Résumé de l’Indice Entrepreneurial Québécois (IEQ) 2021 au bénéfice de Noburo
L’Indice Entrepreneurial Québécois (IEQ) 2021 met en évidence des tendances cruciales pour les travailleurs autonomes et les entreprises de moins de 10 employé·e·s, en pleine période de réajustement après deux ans de pandémie. Cette édition, sous la direction de Rina Marchand du Réseau Mentorat, en collaboration avec des expert·e·s comme Luis Cisneros de l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale et Rahma Chouchane de HEC Montréal, a pour but de mieux comprendre les défis et les transformations vécues par l’écosystème entrepreneurial québécois.
Méthodologie
L’IEQ 2021 repose sur un large échantillon de 19 513 Québécois·e·s, dont 6 228 ont participé au volet principal du sondage, avec un focus sur les intentions entrepreneuriales, les démarches et les entreprises en activité. Ces données ont été collectées entre novembre 2021 et janvier 2022, en pleine pandémie. Ce contexte unique a permis de saisir comment les entrepreneur·e·s ont réagi face aux bouleversements économiques et sanitaires.
Travailleurs autonomes et micro entreprises
Les entreprises de petite taille continuent de représenter une part majeure du tissu entrepreneurial au Québec. En 2021, près de 37,3 % des entreprises employaient entre 1 et 3 personnes, tandis que 7 % avaient entre 6 et 10 employé·e·s. Ces données confirment que les microentreprises constituent une part significative de l’entrepreneuriat québécois, particulièrement dans le contexte pandémique.
Toutefois, la pandémie a exacerbé certains défis pour ces petites structures. Par exemple, la plupart des propriétaires d’entreprises de cette taille ne connaissent pas la valeur marchande de leur entreprise. Seuls 15,3 % des propriétaires de microentreprises de 1 à 3 employé·e·s ont sollicité l’aide d’expert·e·s pour évaluer la valeur de leur entreprise, contre 33,4 % pour les entreprises de 6 à 10 employé·e·s. Cela révèle un manque d’accès à l’accompagnement financier qui pourrait freiner leur croissance.
Le multientrepreneuriat, qui consiste à posséder plusieurs entreprises, continue de croître. Environ 30,6 % des entrepreneur·e·s interrogé·e·s affirment avoir créé plus d’une entreprise. Cela montre une tendance à la diversification, particulièrement importante dans le contexte actuel d’incertitude économique.
Tendances en Haute-Yamaska
Bien que le rapport ne détaille pas spécifiquement les données de la région de la Haute-Yamaska, certaines tendances nationales sont applicables à cette région. En effet, les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et des services professionnels sont en croissance. Le taux des personnes en démarches entrepreneuriales dans le secteur agricole a bondi de 3 % en 2019 à 8,8 % en 2021, plaçant ce secteur parmi les plus dynamiques du Québec.
De plus, 21,9 % des entrepreneur·e·s sondé·e·s souhaitent reprendre ou racheter une entreprise existante, un chiffre pertinent pour des régions comme la Haute-Yamaska, où les petites et moyennes entreprises constituent des opportunités majeures de développement.
L’instabilité en période de pandémie
Le rapport souligne à quel point les deux ans de pandémie ont provoqué des bouleversements pour les entrepreneur·e·s québécois·e·s. Les intentions d’entreprendre ont chuté, passant de 20,4 % en 2019 à 15,1 % en 2021, ce qui démontre l’impact durable des incertitudes économiques. Les démarches, également, ont baissé, atteignant leur plus bas niveau depuis 2013, avec seulement 7,2 % des Québécois·e·s réalisant des démarches concrètes pour démarrer une entreprise.
L’un des obstacles majeurs cités par les entrepreneur·e·s est la pénurie de main-d’œuvre. Un tiers des personnes en démarches a déclaré que cette pénurie rend difficile la création ou la reprise d’une entreprise. De plus, les conditions économiques et sanitaires instables sont perçues comme un frein majeur à l’aboutissement des projets entrepreneuriaux.
Risques pour les entreprises après la pandémie
L’IEQ 2021 révèle que, bien que certaines entreprises aient réussi à se stabiliser, beaucoup restent à risque. Le taux d’entreprises considérées en bonne posture a augmenté de 36,1 % en 2020 à 47,2 % en 2021, mais la part des entreprises en danger de fermeture a presque doublé, passant de 2,1 % à 4,2 %. Les entreprises les plus fragiles sont souvent celles dont les propriétaires ont moins de ressources, notamment dans les secteurs touchés par la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre.
L’IEQ 2021 montre à quel point les travailleurs autonomes et les petites entreprises sont essentiels au dynamisme entrepreneurial du Québec, mais également vulnérables face aux crises. La pandémie a engendré une instabilité durable, freinant les intentions entrepreneuriales et augmentant les risques de fermeture. Cependant, dans des régions comme la Haute-Yamaska, les secteurs agricoles et professionnels offrent des perspectives prometteuses, tandis que le multientrepreneuriat et les reprises d’entreprises représentent des opportunités de résilience et de diversification.
À propos de l’économie sociale
L’Indice Entrepreneurial Québécois en Économie Sociale 2021 met en lumière l’importance croissante des coopératives et des entreprises sociales, particulièrement dans le contexte de la pandémie. Dans ce rapport, plusieurs points clés concernent directement les coopératives ainsi que des tendances applicables à la région de la Haute-Yamaska.
Coopératives et économie sociale
Les coopératives jouent un rôle central dans l’économie sociale québécoise, avec 29 % des entreprises sociales représentées dans l’Indice. Ces coopératives se distinguent par une plus grande robustesse en comparaison avec d’autres formes d’entreprises sociales. Malgré les défis posés par la pandémie, 95,6 % des dirigeant·e·s de coopératives ont déclaré que leur entreprise n’était pas à risque de fermeture, un signe de résilience face à la crise sanitaire.
Les coopératives se démarquent également par leur gestion des ressources humaines. 73,7 % des dirigeant·e·s de coopératives ont exprimé leur intention d’embaucher du personnel au cours de l’année suivante, ce qui est supérieur à la moyenne pour les autres formes d’entreprises sociales. En outre, ces coopératives ont montré une forte capacité d’adaptation en améliorant les conditions de travail des employé·e·s, augmentant les salaires et les avantages sociaux.
Tendances en Haute-Yamaska
Bien que les données spécifiques à la Haute-Yamaska ne soient pas isolées, les tendances générales du rapport peuvent être appliquées à cette région. Les coopératives agricoles et les entreprises dans les services professionnels sont des secteurs en croissance au Québec et correspondent bien au profil économique de la Haute-Yamaska. Les entreprises de l’économie sociale de cette région pourraient également bénéficier de la demande accrue pour les services de proximité, notamment dans les secteurs agricoles et des soins de santé, deux secteurs identifiés comme dynamiques dans le rapport.
Instabilité pandémique et risques post-pandémie
Le rapport souligne les effets de la pandémie sur les entreprises sociales, mais note une résilience notable, particulièrement dans les coopératives. Cependant, la pénurie de main-d’œuvre reste un obstacle majeur, cité par 21,1 % des dirigeant·e·s comme étant le premier frein au développement de leur entreprise. Les effets à long terme de la crise sur le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre sont d’autant plus préoccupants dans des régions comme la Haute-Yamaska, où les entreprises doivent s’adapter rapidement.
Enfin, bien que les coopératives aient démontré une capacité à pivoter et à innover face aux défis de la pandémie, le manque de financement est un autre risque significatif. 82,7 % des entreprises sociales déclarent avoir besoin de subventions pour soutenir leurs opérations courantes, ce qui pourrait poser problème dans un contexte de finances publiques sous pression.
L’IEQ 2021 en économie sociale montre que les coopératives restent un modèle résilient et dynamique au sein de l’économie québécoise, malgré les défis imposés par la pandémie. Dans des régions comme la Haute-Yamaska, ces entreprises pourraient jouer un rôle clé dans la relance économique, en particulier dans les secteurs agricoles et des services. Toutefois, la pénurie de main-d’œuvre et les besoins accrus en financement public et privé représentent des défis majeurs à surmonter pour assurer leur pérennité.
À propos de l’Indice Entrepreneurial Québécois (IEQ)
L’Indice Entrepreneurial Québécois (IEQ) a été créé en 2009 sous la direction de Nathaly Riverin, alors vice-présidente du Centre de vigie et de recherche sur la culture entrepreneuriale de la Fondation de l’entrepreneurship. Elle a joué un rôle clé dans la conception et le lancement de cet outil de mesure, qui visait à comprendre et suivre l’évolution de l’entrepreneuriat au Québec.
Nathaly Riverin, avec son équipe, a conçu l’IEQ pour combler un besoin crucial : évaluer la vitalité entrepreneuriale de la province à une époque où le dynamisme entrepreneurial était perçu comme insuffisant. L’objectif était de créer une mesure récurrente et fiable de la propension des Québécois·e·s à entreprendre, en collectant des données à grande échelle sur les intentions, les démarches, la création et la fermeture d’entreprises.
Sous sa direction, l’Indice est rapidement devenu un outil de référence pour les décideurs économiques et politiques, offrant des analyses précises du comportement entrepreneurial à travers la province. Grâce à sa vision, l’IEQ a contribué à démystifier l’entrepreneuriat et à promouvoir des politiques favorisant la création d’entreprises, devenant un indicateur clé de la santé entrepreneuriale québécoise.